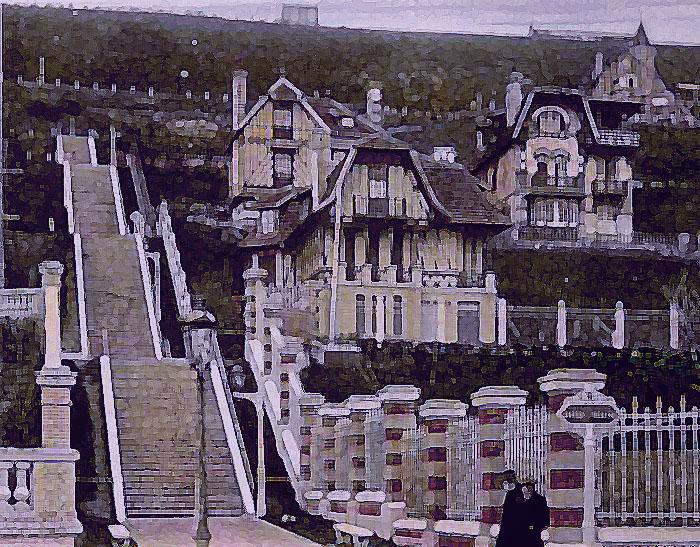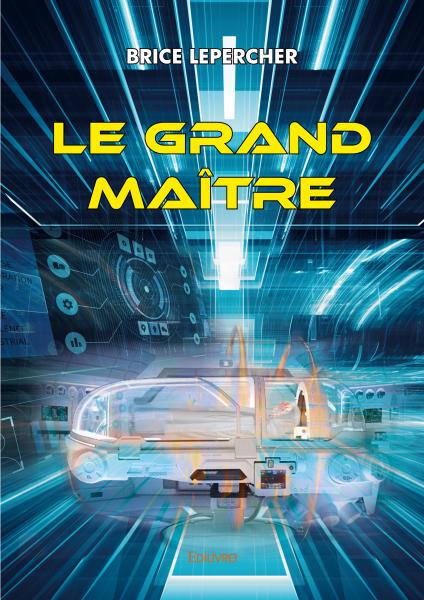À la lumière de l’inachevé
Sophia médita longuement devant son tableau encore inachevé, une toile de cinq mètres sur quatre. Une commande. « Le feu de Dieu ». Putain d’excentrique, rugit-elle entre ses dents. Le coulissement rugueux de la porte la fit sursauter. Milo apparut, un sourire mielleux travestissant sa face d’ours. « Mon client s’impatiente, que puis-je y faire ! », lança-t-il en guise d’excuse. Ses yeux s’arrondirent en s’avançant vers Sophia. Elle se demanda si son amertume se lisait sur son visage. Peut-être était-ce le spectacle de son travail en cours qui provoquait cet air ahuri chez son interlocuteur.
Une contemplation malsaine
‒ Ouah ! Je n’en reviens pas. Quel prodige ! Elle est terminée ?
‒ Absolument pas, s’insurgea Sophia, mâchoire et points serrés. J’ai besoin de cuivre.
La déception se lisait sur les traits poupins de Milo. Encore du cuivre, murmura-t-il sans quitter la toile des yeux. Il y avait tant de vie dans cette peinture, tant à découvrir. Les flammes léchaient un arbre minuscule au fond d’une vallée prisonnière du brasier. On ressentait l’horreur du désastre une fois que le regard se laissait entraîner au cœur de la fournaise. Là, l’observateur se laissait emprisonner à son tour dans la réalité du massacre. L’œil sidéré était bloqué par une contemplation malsaine et toute âme sensible ne pouvait échapper à un sentiment d’impuissance. Milo fit un effort flagrant pour s’extirper de son engourdissement et rabattit son attention sur l’étudiante. La noirceur de ses pupilles le fit frissonner. Il avait envie de crier que le tableau était parfait et qu’il était plus que temps de le livrer. Il voulait en finir avec cette… abomination. Mais, bien sûr, il n’en fit rien. Richmond n’était pas homme à se satisfaire d’un tableau magnifique. C’était un illuminé et Milo retrouvait dans les yeux sombres de Sophia la même puissance inquiétante. Oui, il surprenait parfois dans les prunelles noires de Richmond la même étincelle diabolique.
L’Or du Diable
Du cuivre, répéta-t-il enfin. Je te trouve ça au plus vite. Il avisa un sceau où scintillait cette poudre dorée et le montra du doigt. Il se demandait comment les tubes qu’il lui avait apportés se transformaient en particules sans trouver dans cette pièce nul chalumeau ou autre outil de transformation. Il refusait pourtant de s’interroger plus avant.
‒ C’est loin d’être suffisant.
‒ Combien t’en faut-il encore ?
‒ Dix kilos devraient suffire.
Milo calcula la quantité de cuivre qu’il avait ramené jusqu’à présent et se reteint de demander comment une cinquantaine de kilos pouvaient tenir sur une toile, aussi grande soit-elle.
‒ Parfait, je serai de retour dans deux heures, se contenta-t-il d’ajouter.
Sophia oublia sa colère sitôt qu’il fut parti. L’air froid de la pièce était chargé par les émanations de l’oxyde de cuivre.