La nature humaine est instable
La nature humaine est instable, me disais-je en me levant ce matin. Et, par le plus grand des hasards, je m’entretenais dans la même journée avec deux hommes d’un aplomb désarmant, reléguant aux oubliettes l’impression que l’homme est une espèce trébuchante.
Trois jours que j’écris pour le best-seller. Au quatrième jour, toujours rien publié dans la rubrique d’à côté. Je me réveillais, ce matin-là, avec l’idée déprimante que la nature humaine était instable. Puis, vers l’heure du midi, je croise Vincent Gibeau : « Je me demande si je vais y arriver un jour, lui avouai-je. Comment tu fais, toi ? Tu te poses bien ce genre de questions, des fois.
‒ Non, me répond-il le plus sincèrement du monde. Je ne me pose pas de questions. Je dessine, c’est tout. Enfin, moi, c’est différent. J’ai un boulot, des vacances pour peindre et, j’ai surtout ma famille. C’est un cadre fiable. »
Dans l’élan du blues, je pars à Plein Ciel, la librairie des Docks. Je pense à la montagne de notes que je n’ai pas du tout envie de « traiter », à ces nouvelles perdues dans mon vieil ordinateur qui a rendu l’âme. Oh, je les ai manuscrites, quelque part… Maintenant, j’ai même un disque dur externe. Reste que ces monceaux de notes n’ont d’intérêt que celui que je veux bien leur donner. Courage. Publie et tu seras sauvée !
En réalité, ce n’est pas le plus dur d’écrire. Le plus dur, c’est d’harmoniser son temps entre l’écriture et la structure. Non. J’imagine ce que ferait Gibeau à ma place…

C’est peut-être une question de perception. Si je percevais le tapuscrit autrement. Un nom tout à fait dépourvu de charme, en passant. C’est peut-être ça, le secret : apprendre à vivre les choses autrement.
Plein ciel, la dédicace.
Je trouve notre homme, Brice Lepercher, jonché sur un haut tabouret face à une table de même hauteur, où s’empilent de gros livres au titre évocateur « Le Grand Maître » et à la couverture chiadée. Tous deux respirent le futurisme fictionnel, autrement nommé « science fiction ».

Très vite après m’être présentée, Brice Lepercher invoque sa mémoire d’éléphant pour m’annoncer que nous étions au lycée ensemble. « J’ai une mémoire exceptionnelle et une imagination débordante, explique-t-il. Je n’ai jamais eu le vertige de la page blanche. »
Il m’est souvent arrivé de ne pas reconnaître un ancien camarade de lycée pour la simple et bonne raison que je vivais déjà, à l’époque, dans mon imaginaire, reléguant la réalité extérieure au stricte nécessaire : moi, mes amis et l’inévitable cellule familiale. La famille, encore ! Brice Lepercher est fonctionnaire et sa femme aussi. Et, comme Vincent, Brice évoque un cadre familial solide. C’est pour ça qu’on l’appelle « socle familial », j’imagine.
« Le Grand Maître » est l’histoire d’une prophétie de fin du monde. Nos héros, guidés par un médium, vont avoir la douloureuse mission de sauver l’humanité.
« J’ai mis 20 ans pour l’écrire, clame l’auteur encore sous le choc de sa folle chevauchée. Je vivais tellement dans mon univers que je n’en perdais jamais le fil. Je l’ai écrit sur du long terme parce qu’il fallait que je me construise professionnellement mais, une fois que famille et travail étaient bien imbriqués dans ma vie, je me suis remis dedans quinze ans après, et je n’ai pas eu de problèmes. »
Eh bien, chez nous, la famille est à cloche-pied, me dis-je : un couple qui n’a jamais habité ensemble, aux fortes racines, tellement ensevelies qu’elles sont aujourd’hui invisibles. Bon, passons cette histoire de stéréotypes qui me nargue depuis ce matin et revenons à l’écriture.
Je n’ai pas eu l’occasion de demander à Brice si ce n’était pas trop gênant de se souvenir de tout. Moi, c’est le contraire. Je me fais un devoir d’oublier à peu près tout. Je garde en tête juste ce qu’il faut pour laisser libre cours aux retranscriptions libres de droit. Les références ? Quelques-unes, les plus symboliques.
De l’original sans fondements traitables. J’ai pris le temps de discuter
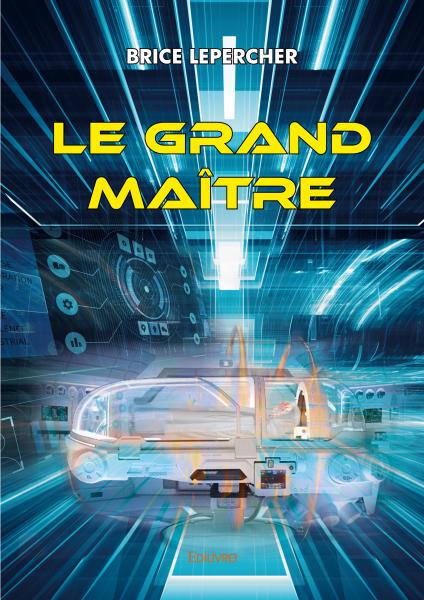
‒ J’ai l’impression d’avoir fait un condensé de toutes mes passions, de toutes mes références livresques et cinématographiques, explique-t-il. Ce qui a relancé l’écriture de mon roman, c’est un départ en vacances. J’avais emmené le manuscrit avec moi sans savoir si j’allais avoir le déclic. Je n’avais pas la tentation de regarder la télé. Alors, l’envie d’écrire m’est revenue.
‒ Comme si tu te faisais ton film, quoi.
‒ C’est carrément le film que j’écrivais. D’ailleurs, je rêve de le voir adapté au cinéma.
‒ Je pense que notre culture est aujourd’hui axée sur l’écriture cinématographique.
‒ Oui, notre culture est basée sur l’image. Elle nous influence tellement que notre écriture s’en nourrit.
‒ Moi, je me gave parfois de films avant l’écriture d’une scène importante, concédai-je.
‒ Complètement ! renchérit Brice. J’aurais peut-être mis moins de temps à écrire sans ma collection de DVD et, en même temps, ça alimentait mon esprit. J’ai mis toutes mes références à la fin du livre : Goldorak, Albator, mais aussi Star Wars, Azimov, Barjavel… Tout ce que j’ai lu ou vu en quarante cinq années de vie. Il y a plein de clins d’œil dans mon bouquin.
‒ Moi, je cherche au contraire à ne pas fourrer toutes les idées qui me tiennent à cœur, pour ne pas risquer de déstructurer mon récit.
‒ Ah mais, j’avais un plan ! Au départ. J’avais pris des notes. Par contre, à la moitié du roman, je me suis laissé aller avec une grande facilité. J’écrivais sans ligne directrice, je ne savais pas où j’allais, et c’était tout aussi intéressant.
Je le suivis sur ce terrain
‒ Jusqu’à maintenant, j’ai toujours opéré comme ça, trouvant l’excuse que, dans la vie, on ne connaît pas la fin. Après, tu remanies pour façonner un début, une fin, etc. mais j’ai toujours écrit mes histoires sans en connaître la fin.
Et la fin vola en éclat
‒ Moi, la fin, je l’ai improvisée. Je savais ce que j’allais écrire au départ mais quand tu écris 400 pages ce n’est pas pareil que quand tu en écris 100. Je ne sais pas si je serais capable d’écrire plus court. J’ai toujours été prolixe. C’est Jacques Derouard qui m’a donné le virus de l’écriture tout en me poussant à structurer avec un plan. Un conseil qui n’a pas été suivi jusqu’à la fin.



